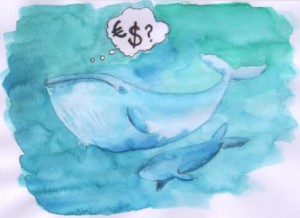J’ai été frappée il y a quelques années par le fait de devoir, dans le cadre de mes activités professionnelles, traduire en euros tout un tas de biens environnementaux (qualité de l’eau, paysage, biodiversité…). Et peut-être plus encore par le fait de rencontrer des économistes accordant crédit à ces chiffres. Je suis alors tombée sur un article du philosophe Patrick Viveret qui tournait ce type de pratiques en dérision : selon un tel raisonnement il semblait logique d’approcher monétairement la valeur mondiale de l’amour en multipliant le coût d’une passe par le nombre d’êtres humains en âge d’avoir des rapports sexuels… Viveret concluait sur l’impossibilité de quantifier ce qui a le plus de valeur (au sens premier du terme : la force de vie).
Constatant que le sujet faisait couler de l’encre, mais néanmoins toujours interloquée par le fait de devoir tout de même chiffrer la nature pour justifier des objectifs environnementaux, j’ai alors coordonné un numéro de la revue Ecorev intitulé “Quelle(s) valeur(s) pour la biodiversité ?” (dans lequel je recommande vivement la lecture d’une interview de Viveret, qui résume très bien la question à mon sens).
Plus récemment, avec quelques éléments plus concrets à mon actif, j’ai également essayé avec d’autres d’interroger la démarche, dans un article publié par Nature Sciences Sociétés.
Il est un fait que les canons de l’action publique voudraient que toute décision publique, tout projet, y compris environnemental, repose sur une analyse coûts bénéfices, qui consiste à comparer les bénéfices issus de l’action à son coût, afin de ne pas utiliser le denier public pour des projets trop coûteux par rapport à leur intérêt pour la société – intention plutôt louable en soi ! Cette analyse qui se veut rigoureuse rencontre cependant un certain nombre d’obstacles. Tout d’abord, on compare des choux et des carottes : d’un côté des coûts concrets, susceptibles de figurer dans une comptabilité, de donner lieu à un transfert monétaire réel, de l’autre des estimations certes traduites en euros, mais la plupart du temps abstraites. En effet, la plupart des impacts environnementaux d’un projet sont “non-marchands” (c’est-à-dire non substituables par des bien échangeables sur un marché, comme la beauté d’un paysage, la présence d’animaux qu’on n’approchera peut-être jamais, le bon fonctionnement de l’écosystème… ces aspects sont évidemment bien plus délicats à quantifier et à traduire monétairement) . Pour approcher de manière globale la valeur monétaire des “bénéfices non-marchands”, la méthode la plus utilisée consiste à réaliser une enquête “d’évaluation contingente” auprès des riverains, dans laquelle on demande aux gens combien ils sont prêts à payer pour que l’environnement soit en meilleur état (ou combien ils sont prêts à recevoir en cas d’impact négatif). Petite remarque en passant : il est évident que le quidam moyen n’aura pas conscience de l’ensemble des bénéfices à moyen et long termes d’un écosystème fonctionnel… On obtient à la fin un coût unitaire par personne, qu’on multipliera ensuite par la totalité de la population concernée. Le problème central, c’est le choix arbitraire de la population à laquelle on va attribuer la valeur unitaire : comment savoir, par exemple, qui est prêt à payer pour la restauration des marais d’Episy ? Je pourrais allonger la liste des critiques attribuables à cette méthode, mais ce qui est déjà évoqué suffit je pense à décrédibiliser l’analyse coût- bénéfices pour ce qui concerne les biens environnementaux.
Mon propos n’est cependant pas de dire que tout chiffrage de la nature est vain : certaines valeurs monétaires ont du sens et peuvent “parler” aux décideurs, mais elles sont toujours à considérer “a minima” car elles ne prennent bien souvent en compte qu’une partie du problème. Par exemple, le coût de la disparition des abeilles est estimé à 153 milliards d’euros, sur la base d’un chiffrage de l’activité des insectes pollinisateurs. Un tel chiffre peut-il suffire à éveiller les consciences et à empêcher le drame de leur disparition ? Prenons un autre chiffre, célèbre et sans cesse rabâché, produit en 1997 par l’économiste américain Costanza : il a estimé la valeur des écosystèmes mondiaux à 33 000 milliards de dollars, à comparer aux 18 000 milliards de dollars de PIB mondial de l’époque. Cela a-t-il permis de ralentir les processus de dégradation…?
Finalement, comme le souligne Patrick Viveret, “si la quantification, qui ne prend sens que dans certains contextes, devient une finalité, alors on dérape et on met en cause le processus démocratique. En effet si la quantification était suffisante, il suffirait de mettre la société en pilotage automatique sur la base d’un logiciel. La démocratie, au contraire, est un processus qualifiant, puisqu’il s’agit de délibérer sur ce qui a de la valeur, de hiérarchiser entre ce qui compte le plus et le moins.”
Sarah Feuillette